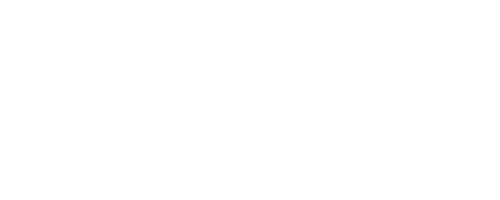L’exposition Suzanne Valadon m’a à la fois émue et interpellée.
Il y a d’abord cet effort notable de réunir les œuvres de cette artiste, d’être allé chercher des pièces dans des collections particulières dénicher ces nombreux portaits et natures mortes.
L'exposition suit un découpage téhmatique : l'apprentissage en tant que modèle, les portraits, le dessin, le nu, les natures mortes notamment de fleurs et bouquets...
Les salles consacrés aux nus sont nombreuses et fournies, témoignant de la grande production réalisée par l'artiste, dans le prolongement de ses talents de dessinatrice. C'est intéressant et cela dit quelque chose de l'appropriation par Suzanne Valadon de cet exercice incontournable, figure imposée de tout artiste peintre et longtemps interdit aux femmes.
Parler du regard féminin sur le nu est une approche nouvelle et pertinente. C'est une bonne chose qu’un grand musée s’y attelle, en profitant de l'importante production de l'artiste en la matière.
Cependant le thème du "female gaze" versus "male gaze" est tellement à la mode aujourd'hui qu'il donne à mon avis un prisme trop fort à l'exposition, qui éclipse d'autres questions que j'aurais aimé voir traitées.
L’influence de Suzanne Valadon sur son époque
Par exemple : Quelle a été l'influence de Suzanne sur son époque? Deux hypothèses peuvent à mon sens être formulées :
La première étant que les femmes artistes ont été peu regardées, étudiées et reconnues en raison de la doxa dominante, qui considérait leur travail comme moins abouti, moins profond, moins mûr que celui des hommes.
Cela pourrait expliquer pourquoi Suzanne Valadon a été peu étudiée, critiquée et a eu, en conséquence, une influence limitée. Néanmoins, elle reste l’une des premières femmes à être admise à l’Académie des Beaux-Arts, un point qui a été brièvement abordé dans l’exposition, mais qui aurait supporté une mise en perspective plus grande. Par exemple, avant elle, il y a eu Berthe Morisot et sa présence au salon des indépendants, Mary Cassat, Eva Gonzales, même si celles-ci viennent de milieux plus favorisés et plus tolérants peut-être quant au souhait d'une femme de devenir peintre.
La personnalité farouche et dure de Suzanne Valadon, sa vie sulfureuse la fait attraper à bras le corps les sujets tabous et polémiques comme l'odalisque ou le nu masculin, alors que ses prédécesseuses plus bourgeoises contournent la difficulté et exercent leurs pinceaux sur des scènes d'intérieur ou de genre typique et circonscrites à la vie des femmes de bonnes famille. -
Cela dit, je suis consciente de l'écueil : parler des femmes artistes uniquement parce qu’elles sont femmes peut être réducteur, au lieu de considérer leur œuvre en elle-même. Toutefois, il est essentiel de replacer les choses dans leur contexte : être une femme artiste à cette époque était un défi. La reconnaissance était plus difficile à obtenir, ce qui implique forcément un biais dans la perception et la réception de leur travail. De ce fait, le sillon tracé par les femmes artistes depuis le début du XIXe siècle pouvait être un point d'appui.
Comparaisons et mise en perspective
La seconde hypothèse est celle d'une Suzanne Valadon, non classable et indépendante dans le bouillonnement artistique de ce début XXe.
Comment s'inscrit-elle dans les nombreux courants artistiques de cette époque? Symbolisme, nabis, fauvisme, expressionisme...
Comment la situer par rapport à des Kirchner, Van Dongen, Modigliani? Certains sont présents à Montmartre à cette époque, où elle travaille et habite. Les connait-elle? Les fréquente-t-elle? On connait ses relations et l'influence des maîtres impressionistes pour qui elle a posé Degas, Renoir, Puvis de Chavanne, Toulouse Lautrec... à la fin du XIXe siècle.
Un point mentionné brièvement dans un cartel, mais qui aurait mérité d’être davantage développé, est qu’elle n’appartenait précisément à aucun courant défini. C’est un élément fascinant, car elle aurait pu se contenter d’être une simple copie féminine d’un Kirchner ou d’un Degas, mais elle a choisi de ne s’inscrire dans aucune école et de suivre sa propre voie.
Conclusion : une reconnaissance encore incomplète
Sur un plan positif, c’est formidable de voir enfin Suzanne Valadon bénéficier d’une grande exposition avec plusieurs salles et de nombreuses œuvres montrant l'ampleur de son travail. ne disait-elle pas elle-même (et cette phrase est bien mise en exergue dès l'entrée de l'exposition) : "
Cette exposition met peut-être aussi en lumière les difficultés persistantes dans la manière dont on aborde l’œuvre des femmes artistes.
Je dis cela avec prudence, car je ne suis pas historienne de l’art, mais mon ressenti est qu’il reste encore du chemin à parcourir pour considérer pleinement l’œuvre d’une femme avec autant de profondeur et de recherche thématique que lorsqu’il s’agit d’un « grand maître ». On cherche systèmatiquement ce qui pourrait être lié au genre et de ce fait distinguer son approche de celle d'un homme. Alors qu'il faudrait peut-être aborder cette grille de lecture inévitable mais s'en détacher pour parler du trait, du style, de la touche, de la recherche, de l'évolution plutôt que du sujet.
Peut-être Suzanne Valadon n'intéressait personne, et surtout pas les grands artistes de l'époque parce qu'elle était femme... Ou peut-être était-elle tout simplement une figure à part dans le paysage artistique du début du XXe siècle. Inclassable et têtue.